Entre la RDC et son voisin Rwandais, les faits regagnent en clarté. Si l’opinion internationale fait preuve de son habituelle apathie face à l’insécurité entretenue depuis 3 décennies à l’Est de la RDC, à l’interne, on ne se fait plus guère d’illusion : les squatters rwandais du sol et du sous-sol congolais n’entendent pas dégager. Et tous les dialogues n’y peuvent rien.
Si l’Ouganda de Yoweri Museveni fait preuve de souplesse en se ménageant une voie de sortie économico-commerciale à travers la construction de routes d’intérêts communs en territoire congolais, doublée d’un soutien militaire pour l’éradication des forces négatives qui lui assurent de garder un pied sur le territoire de son voisin, il en va tout autrement du Rwanda de Paul Kagame, résolument belliciste comme à l’accoutumée.
Kigali ne dissimule même plus, au-delà de ses ambitions expantionnistes territoriaux sa mainmise sur une partie du territoire congolais et rue dans les brancards pour s’y accrocher. L’escalade des affrontements entre les FARDC et les phalanges des RDF sous le couvert d’une pseudo rébellion du M23 depuis le dernier trimestre 2021 l’illustre. Rien ne semble faire reculer Kagame.
Bunagana conquis par les RDF
Dans un communiqué publié le 11 juin 2022, le ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a rappelé l’occupation, attestée par des images de drones, des collines congolaises de Chanzu et Runyonyi par l’armée rwandaise et ses supplétifs et dénoncé la poursuite des opérations militaires de Kigali ainsi que son soutien à tout ce que le Kivu compte de groupes irrédentistes.
Vendredi 10 juin, une dizaine d’obus tirés par les RDF s’étaient abattus sur Biruma et Kabaya en territoire de Rutshuru, y détruisant notamment l’Institut St Gilbert, tuant net deux enfants de 6 et 7 ans. Après une relative accalmie sur le front, les affrontements sont repartis de plus belle dimanche 12 juin lorsque les assaillants ont attaqué des positions FARDC, notamment à Bigega, près de Bunagana, entraînant une prompte réplique. A la mijournée, des sources dans la région faisaient état de collines récupérées par les troupes loyalistes congolaises et de débandade dans le camp du M23 avant que l’armée rwandaise ne vole ouvertement à la rescousse de ses supplétifs en difficulté.
Lundi 13 juin au terme d’âpres combats, Bunagana est passé sous contrôle RDF-M23. Dans un communiqué, le général FARDC Sylvain Ekenge le confirmait en déclarant que «les forces de défense rwandaises ont cette fois décidé de violer notre intégrité territoriale en occupant la ville frontalière, ce qui constitue une invasion de la RDC». L’in¬tervention rwandaise à Bunagana est confirmée par plus d’une source, et notamment l’opposant rwandais Faustin Twagi¬ramungu pour qui «Buna-gana a été prise par l’armée rwandaise au nom du M23». Mais pas seulement. Ce que Kigali ne nie même plus. Un communiqué laconique des RDF assure en effet que «la défense et la sécurité de la population rwan¬daise, ainsi que l’intégrité territoriale du Rwanda sont assurées, et que les FDLR (Mouvement d’exilés rwandais en RDC) continueront à chercher des garanties que les attaques transfrontalières sur le territoire rwandais soient arrêtées». Trois jours avant l’assaut sur Bunagana, Kigali avait convoqué la chargée d’affaires congolaise au Rwanda pour dénoncer ce qui était présenté comme des «agressions» et des «provocations» de la RDC.
Selon des sources dans la société civile locale, les M23-RDF auraient été rejoints sur le terrain par les forces spéciales ougandaises. Elles précisent que les affrontements de dimanche soir «se sont intensifiées quand l’armée ougandaise est passée par Kibaya pour couper la route aux FARDC à hauteur de Premidis aux alentours de 20 h, les encerclant de fait dans Bunagana pris en étau». Des faits confirmés par quelques riverains de la zone frontalière de Bunagana assurant avoir aperçu des camions de l’armée ougandaise transportant des troupes à Basoro, Kashire, Kibaya et Bigega, des villages en territoire congolais d’où les positions des FARDC ont été attaquées mais qui restent à vérifier car, selon un spécialiste de la région, le Rwanda, déjà en délicatesse avec le Burundi et la Tanzanie, pourrait user d’un tel stratagème pour enfoncer un coin dans la coalition congolo-ougandaise et se mettre ainsi à l’abri d’un isolement fatal.
Mercredi 8 juin 2022, les FARDC avaient déjà fait état de la présence au front aux environs des collines de Chanzu et Runyonyi en territoire de Rutshuru de 500 éléments des forces spéciales RDF venus en renfort au M23. Sur le territoire congolais, ces éléments se sont attaqués à la MONUSCO à Muhati près de Bikenge (Jomba), selon un communiqué du général Ekenge qui confirmait une communication de la mission onusienne quelques heures plus tôt.
Lundi 6 juin, le front de Rutshuru avait été rallumé lorsque les terroristes du M23 ont attaqué une position FARDC à Bugusa en groupement de Jomba, tuant des militaires et blessant 5 autres. Dans la riposte qui s’en est suivie, les troupes loyalistes ont réussi à déloger les rebelles de la colline de Muhusi et progressaient vers Chanzu et Runyonyi, toujours entre les mains des rebelles soutenus par l’armée rwandaise, ainsi qu’en témoignaient de tirs de canons à longue portée essuyés par les FARDC.
Au renfort en armement, Kigali ajoutait donc carrément une rescousse en hommes, affichant ainsi sa volonté de ne reculer devant rien.
Le 28 mai 2022, deux militaires rwandais étaient capturés par les FARDC en territoire congolais. Kigali a aussitôt exigé leur libération, reconnaissant ainsi leur appartenance à ses unités combattantes sans pour autant lâcher du lest.
Coup de pied dans un essaim d’abeilles
Jeudi 2 juin 2022, le parlement congolais a prolongé pour la énième fois l’état de siège au Nord- Kivu et en Ituri, décrété par le président Tshisekedi en mai 2021, pour enrayer l’insécurité dans cette partie du pays.
C’est la plus forte décision politique prise pour rétablir la sécurité mise à mal dans la région depuis les années Mobutu. Elle semble avoir déplu à plus d’un, en RDC comme dans la région et dans la communauté internationale occidentale.
Félix Tshisekedi donnait ainsi un coup de pied dans un véritable essaim d’abeilles qui sommeillaient ou faisaient semblant. Parce que chez les voisins Rwandais particulièrement, les réactions ne tardèrent pas, ce pays mettant en branle aussitôt des antennes dormantes de «rebelles proxies» tapies sur son territoire et lançant des appels du pied à peine voilés pour intervenir militairement en territoire congolais. Et ainsi empêcher Kinshasa de rétablir la souveraineté sur cette partie de son territoire.
Vendredi 4 octobre 2021, un peu plus de 3 mois après l’instauration de l’état de siège dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, la police rwandaise annonçait ainsi, pince-sans-rire, l’arrestation de 13 personnes soupçonnées d’avoir planifié des attaques « terroristes » à Kigali et les exhibait devant la presse. «Les suspects ont été arrêtés avec du matériel pour fabriquer des bombes, notamment des explosifs, des fils, des clous et des téléphones. Les investigations ont révélé que la cellule terroriste travaillait avec les Forces Démocratiques Alliées (ADF)», expliquait un communiqué de la police rwandaise auquel aucun observateur sérieux n’accordait le moindre crédit. Parce qu’aucun terroriste sérieux ne peut se hasarder à narguer les services de sécurité rwandais connus pour leur cruauté au Rwanda ou ailleurs à travers le monde. L’astuce ne payait pas de mine et fut abandonnée pour des méthodes d’intervention plus directes.
Lundi 18 octobre 2021, quelques mois seulement après que Kinshasa eût concédé la signature d’accords bilatéraux sur les investissements transfrontaliers, la fiscalité et l’exploitation conjointe d’or avec Kigali, les RDF ont opéré une incursion soudaine au Congo à partir du village de Kitotoma (Buhumba), provoquant le déplacement massif des populations de quelques 7 villages du territoire de Nyiragongo. Un accrochage, le tout premier entre les deux armées, s’en était suivi, que les autorités des deux pays minimisèrent autant que faire se peut.
Le 8 novembre 2021, était annoncé la renaissance du M23, responsable d’attaques armées contre les positions des FARDC sur les collines de Chanzu et Runyonyi, encore sous occupation au moment où nous mettons sous presse.
Ajoutée à ces conflagrations la présence ininterrompue (mais niée) de l’armée rwandaise en territoire congolais, plus précisément au Nord-Kivu jusqu’en 2020, dénoncée par le Groupe d’experts des Nations-Unies sur la RDC et on peut se faire une idée du véri¬table essaim d’abeilles que représente la région littéralement écumée par la principauté militaire de Paul Kagame. Selon un vieux sécurocrate congolais, «en réalité, toute la région de Masisi est sous occupation rwandaise». Son affirmation est confirmée par un urbaniste, de retour d’un colloque scientifique à Goma qui fait observer que tous les immeubles érigés le long du lac Kivu dans cette ville sont propriétés de sujets rwandais. C’est tout dire.
Chez le voisin ougandais, au dernier semestre 2011, des attentats terroristes avaient refait surface. Samedi 23 octobre à Kampala, quelques sus¬pects identifiés plus tard comme des terroristes ADF y avaient fait exploser une bombe dans un restaurant populaire, provoquant la mort d’une serveuse et blessant grièvement trois personnes. Alors que le 8 octobre, un autre attentat à la bombe contre un poste de police de Kawempe, près du même restaurant, était revendiqué par l’organisation djihadiste Etat Islamique (EI). Au mois d’août, un attentat suicide visant les funérailles d’un haut gradé de l’UPDF avait été attribué par le président Museveni aux terroristes ADF. 4 suspects avaient été arrêtés et un cinquième tué en juillet à la suite d’un attentant contre le ministre ougandais des transports. «Ils s’étaient entraînés avec les ADF en RDC et avaient commencé à réactiver des cellules terroristes locales», selon la police ougandaise. Cela a poussé Yoweri Museveni à multiplier les appels du pied en direction de son homologue congolais Félix Tshisekedi pour une mutualisation des forces contre l’hydre terroriste en RDC. C’est fait depuis le déclenchement des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF pour venir à bout des ADF et des milices nationales qui au Nord-Kivu et en Ituri. Au grand dam de Paul Kagame qui a l’impression d’avoir été abandonné.
La guerre, plus proche que jamais
La situation sécuritaire à l’Est de la RDC est donc des plus explosives. Kinshasa et Kigali n’ont jamais été aussi prêts d’une guerre ouverte.
Depuis lors en effet, le président Tshisekedi a dénoncé sans ambages le soutien de Kigali au M23, qualifiant cette énième phalange armée du Rwanda de mouvement terroriste et se refusant à toute négociation avec elle. «Certains se trompent en considérant que le Congo un espace de non-droit, une sorte de marché libre où l’on vient se servir comme on veut et on s’en va. Nous ne l’accepterons jamais. Nous resterons toujours fermes et déterminés à défendre la souveraineté, l’intégrité territoriale et l’indépendance de notre pays», précisera son ministre des Affaires étrangères Lutundula aux médias.
Au terme d’une visite officielle à Oyo au Congo- Brazzaville, Tshisekedi lançait pour sa part un message on ne peut plus clair. «Le fait de vouloir la paix, la fraternité et la solidarité n’est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir», déclarait-il le 5 juin au cours d’un point de presse conjoint avec son homologue Denis Sassou Ngouesso. «J’espère que le Rwanda a retenu cette leçon parce que, aujourd’hui, c’est clair, il n’y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la RDC», avait-il martelé. Entre Kinshasa et Kigali, on n’en était jamais arrivé à une telle escalade verbale, depuis le Mzee Laurent-Désiré Kabila. Mais rien n’y fait.
Le 31 mai 2022, une réunion du conseil de sécurité des Nations-Unies consacrée au conflit de l’Est de la RDC s’est achevée sans la moindre condamnation de Kigali, au grand regret de la RDC.
A l’exception notable de la Chine, les ‘‘big five’’ ont conseillé le dialogue pour résoudre un différend dont on sait pourtant qu’il résiste au dialogue depuis trois décennies sans amoindrir le coût de l’insécurité entretenue par le Rwanda. En plus des morts, près de 72.000 Congolais ont été déplacés par les combats qui font rage au Nord-Kivu, dont 7.000 pour les derniers affrontements de Nyiragongo et de Rutshuru, qui ont trouvé refuge en Ouganda, selon le HCR, auxquels il faut ajouter quelques 5,6 millions de déplacés internes errant ci et là à l’intérieur de la province.
En marge de la réunion du conseil de sécurité, fin mai 2022, Washington, par la bouche du secrétaire d’Etat Anthony Blinken a promis de soutenir «la paix, la sécurité et la stabilité dans l’Est de la RDC» et convenu avec Lutundula de l’importance d’un dialogue régional continu pour régler le conflit en cours, faisant sans doute allusion au processus de Nairobi qui recommande des négociations avec les forces rebelles. Tandis que le secrétaire général de l’ONU dépêchait dans la région son Envoyé spécial, le Chinois Huang Xia qui, dès l’étape de Kigali, annonçait les couleurs le 4 juin à la grande satisfaction de Kagame en déclarant avoir «rassuré le Rwanda sur la position ferme de l’ONU contre les discours de haine et l’incitation à la violence. Le discours de haine est une menace pour la stabilité et la paix et ne peut jamais être justifié contre qui que ce soit, n’importe où n’importe quand». A Goma le même jour, le diplomate onusien a tenté de se rattraper en assurant que «nous poursuivons nos efforts pour la paix. Les populations de l’Est de la RDC n’ont pas besoin d’une nouvelle guerre», sans dissimuler la place exiguë que les Nations- Unies réservaient ainsi aux préoccupations sécuritaires et territoriales d’un pays membre. «Il nous semble que la communauté internationale est plus préoccupée par les discours de haine et incitations à la violence des Congolais qui pourraient gêner le Rwanda que par les milliers de victimes congolaises qui meurent ou sont forcés quotidiennement à l’exil à cause de cette agression. Il est temps de se dire des vérités difficiles», réagissait à ce propos Francine Muyumba Nkanga, sénatrice congolaise membre de l’opposition, qui résume parfaitement l’opinion générale en RDC.
Diplomatie du statu quo
L’escalade de la tension entre Kinshasa et Kigali n’a pas non plus manqué d’interpeller les Africains. Le président sénégalais Macky Sall qui est à la tête de l’Union Africaine s’était personnellement saisi du dossier en s’entretenant au téléphone avec ses homologues congolais et rwandais avant de refiler la patate à l’Angolais Joao Lourenço, président en exercice de la CIRGL qui, à son tour, s’est entretenu avec les deux chefs d’Etat. Ces derniers ont présenté leurs argumentaires mais on ne voit toujours rien advenir.
Alors qu’entretemps, le processus de Nairobi poursuit son bonhomme de chemin sans rassurer outre mesure. Du 6 au 7 juin 2022 s’est tenue à Goma, à l’invitation du chef d’Etat-Major général des FARDC, le général Célestin Mbala, une réunion des chefs d’état-major des forces de défense de l’EAC. Elle avait pour but de «passer en revue la situation sécuritaire dans l’Est de la RDC et d’examiner le rapport des experts qui se sont réunis du 4 au 6 juin 2022 à Goma» et de «discuter de la mise en place d’une force régionale pour contenir, vaincre et éradiquer les forces négatives qui écument la partie Est de la RDC». Sans plus, quoiqu’en ait dit certains médias. Le communiqué final publié mardi 7 juin indique en effet que les «recommandations prises lors de cette réunion seront consolidées aux prochaines assises des experts et des chefs des forces de défense le 19 juin 2022 à Nairobi au Kenya avant la validation par les chefs d’Etat de la Communauté». En réalité, les chefs des forces de défense de l’EAC ne se sont pas accordés sur la condamnation de Kigali, qui a du reste séché la réunion présidée par le général kenyan Robert Kibochi, selon des sources proches du dossier. Et que les espoirs suscités par la mise en oeuvre d’une force militaire régionale pour éradiquer les forces rebelles doivent être revus à la baisse.
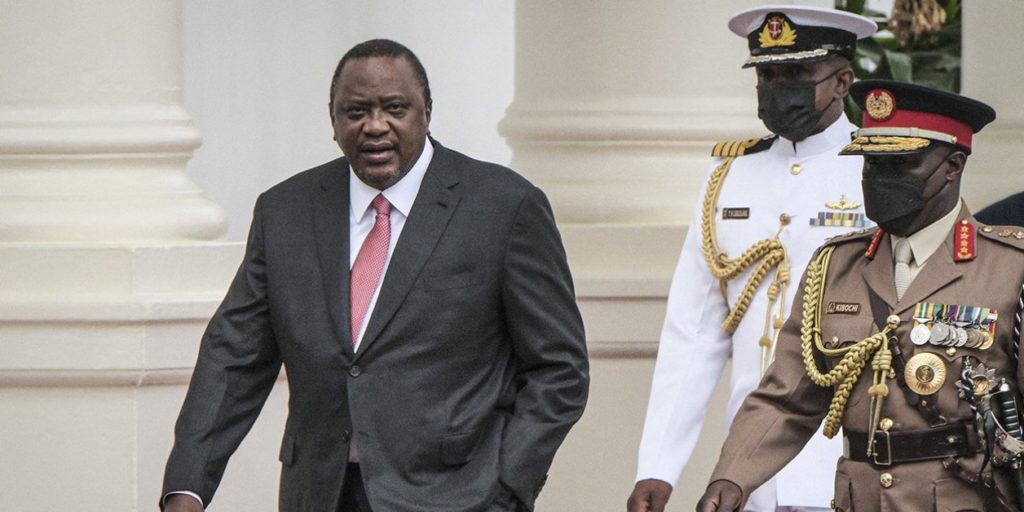
Compter sur ses propres forces
Ce en quoi Kinshasa ne semble pas se leurrer outre mesure, Christophe Lutundula, le ministre Tshisekedi des Affaires étrangères a lâché entre deux propos devant des médias qu’«il n’appartient pas aux armées étrangères de venir défendre notre intégrité territoriale». Sur ce point, le patron de la diplomatie congolaise émet sur la même longueur d’ondes que son président: la RDC ne doit compter que sur ses propres forces de défense. Mercredi 8 juin au cours d’un point de presse conjoint avec le Roi Philippe de Belgique en séjour en RDC, Félix Tshisekedi a avoué que l’ambition de son pays «est de monter en puissance au niveau de nos forces de défense et de sécurité pour être suffisamment dissuasif. Il n’y a pas de développement sans sécurité, il n’y a pas de stabilité sans paix. S’il y a une priorité que nous attendons de la Belgique, c’est bien un accompagnement dans ce sens. Il y a déjà un début d’accompagnement parce que la coopération militaire a repris avec Belgique, la formation des troupes d’élite, c’est fait déjà en ce moment».
Entre Kinshasa et Kigali, ce sont les paramètres qui ont jusque-là présidé aux dialogues et discussions de paix qui doivent changer, selon plusieurs observateurs. L’argument sécuritaire fondé sur la crainte de la résurgence du génocide rwandais, tiré à hue et à dia, ne tient plus la route. Entre 800.000 victimes tutsi et hutu modérés atrocement décimés en 1994 et quelques 10 millions de Congolais morts des suites directes ou indirectes de ce conflit, la comparaison est trop inégale et finit par lasser les plus grands protecteurs de Kigali. D’autant plus que du pays de Kagame lui-même s’élèvent, malgré la chasse systématique et implacable aux opposants qui y est à l’oeuvre, des voix pour dire non et en appeler à un dialogue rwando-rwandais qui rassure plus durablement que les agressions militaires contre les voisins.
Revisiter les paramètres du conflit
C’est, notamment, le point de vue de Victoire Ingabire, présidente du parti Dalfa-Umurinzi, qui, dans une récente tribune libre dans un média occidental, estime qu’il y a des raisons inquiétantes qui nécessitent un nouveau dialogue inter-rwandais dans l’objectif de réformer le système de gouvernance au Rwanda afin de garantir une stabilité durable dans le pays et la région des Grands Lacs. «Cela fait plus d’une décennie que la communauté internationale tente de trouver une solution au problème de l’instabilité dans la région des Grands Lacs. J’ai toujours soutenu que sans résoudre le problème politique du Rwanda, il sera impossible d’apporter la stabilité dans cette région. Il est donc opportun et approprié que les parties prenantes régionales et internationales soutiennent le projet de dialogue inter rwandais proposé pour la réforme de gouvernance au Rwanda seul garant de la consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs», martèle Mme Ingabire.

La thèse de l’opposante rwandaise rencontre le point de vue de nombreux Congolais agacés par la politique de deux poids deux mesures mise en oeuvre par les puissances occidentales qui soutiennent Paul Kagame en imposant, pour la énième fois, la RDC à négocier avec son opposition armée sans exiger la même chose du Rwanda dont les rebelles ont sanctuarisé l’Est du territoire national.
Kagame : des fissures dans la cuirasse
Certes, les dernières prises de position au Conseil de sécurité sur le conflit de l’Est de la RDC furent peu encourageantes. Mais des fissures dans la cuirasse internationale de Kagame se dessinent et s’accentuent, depuis la désormais célèbre affaire Rusesabagina, l’opposant rwandais récemment enlevé à Dubaï et condamné à une vingtaine d’années de prison au terme d’un procès expéditif.
Outre la condamnation, certes du bout des lèvres, par l’administration Biden, le procès du célèbre héros de «Hôtel Rwanda» a sérieusement entamé les relations entre le Rwanda et ceux qui en Occident avaient tendance à lui donner le bon Dieu sans confession. Au fil des ans, le président rwandais et son pouvoir autocratique apparaissent au monde tel qu’ils sont. «Kagame et ses partisans ne semblent pas très enclins au dialogue, une fois de plus. Peut-être n’en sont-ils pas capables non plus. Ils fuient le débat approfondi où les mots des uns et ceux des autres, les arguments et les contre-arguments, sont patiemment et calmement expliqués et pesés. Trop souvent, nous devons nous contenter d’une attitude témoignant de faiblesse intellectuelle et morale : des attitudes dénigrantes et arrogantes, des slogans et de la propagande, des reproches et des accusations, des mensonges ou des histoires tronquées. Les observateurs sont de moins en moins nombreux pour apprécier un discours lamentablement réducteur et amer», estime l’ancien Ambassadeur belge Johan A. Swinnen, auteur d’une tribune parue en septembre dernier.
Plus de complexe de culpabilité
Contre Kagame, le diplomate belge a vidé son sac quasiment, signe que le temps de grâce dont bénéficie l’homme fort de Kigali s’effrite. «Peu à peu certaines choses deviennent plus claires. L’indulgence, voire la flatterie, avec lesquelles les réalisations du régime Kagame ont été applaudies, font désormais place à de sérieux doutes, voire à un jugement critique. Des aspects plus sombres du même « modèle » deviennent plus difficiles à étouffer ou à maquiller. Bien que les masques de Kagame soient tombés et que les oeillères des admirateurs aient disparu depuis un certain temps déjà, beaucoup disent aujourd’hui : ça suffit. Kagame doit être rappelé à l’ordre et rendre des comptes, tant pour son passé que pour ses pratiques actuelles, qui bafouent les droits de l’homme. Le complexe de culpabilité de la communauté internationale pour son comportement négligent pendant le génocide, que Kagame a habilement exploité, approche de sa date d’expiration», estime-t-il.
Swinnen n’est pas le seul à porter un jugement aussi sévère sur Kagame. La RDC devrait en profiter pour faire entendre sa cause dans la bienpensante communauté internationale si sourde jusque-là à ses complaintes.
Bruxelles soutient Kinshasa
Mercredi 8 juin à Kinshasa, le 1er ministre belge, Alexander De Croo, a promis au président Tshisekedi et aux Congolais que son pays était prêt à jouer un rôle «pour que le territoire congolais soit respecté par ses voisins». Cela n’avait pas été entendu depuis des lustres d’un officiel belge de ce rang. «Chaque pays a le droit de défendre l’intégrité de son territoire. Vous avez le droit d’exiger à vos voisins que votre territoire soit respecté. Vous avez le droit de demander à chacun de vos voisins de faire les choses qui sont nécessaires pour éviter qu’il y ait une situation d’insécurité dans votre pays. Ce sont des règles de base. Il faut appeler vos voisins à prendre leurs responsabilités. Si vous estimez que c’est nécessaire. La Belgique est prête à jouer un rôle pour que ces responsabilités soient respectées», avait bûcheronné De Croo, qui, à défaut d’une condamnation formelle de Kigali, donne ainsi raison à Kinshasa dans le conflit qui endeuille ses populations de l’Est du pays.
Pour déloger les squatters du territoire national dans les Kivu et en Ituri, il faudra allier force militaire et sou¬tien diplomatique. Félix Tshisekedi et son gouvernement semblent l’avoir compris.
J.N
